Pink Floyd, l'écho système
Transcription de l’article Pink Floyd, l’écho Système publié le 19 décembre 2001 dans le n°2710 de Télérama. Il s’agit principalement d’une interview de David Gilmour et de Roger Waters. Propos recueillis par Hugo Cassavetti.
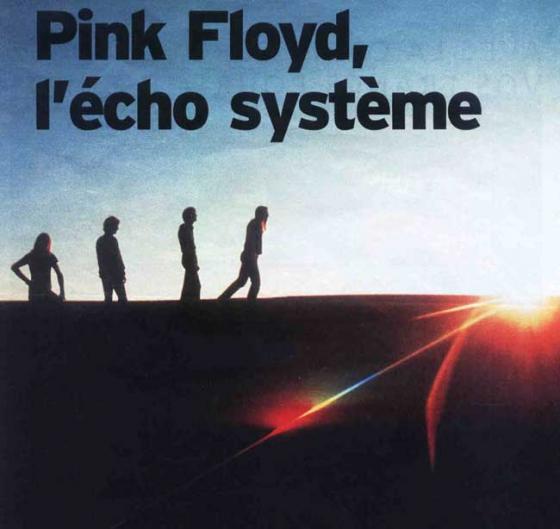
Ils se sont depuis longtemps éclipsés de la scène. Mais leurs albums se vendent toujours par millions. Et leur univers sonore irrigue la jeune génération électro-rock. Pour Pink Floyd, groupe mythique et mal-aimé, l’heure de la reconnaissance a sonné.
Pink Floyd, alias Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright, Nick Mason, avait tout pour devenir un groupe de rock mythique : une démarche novatrice, un son à part, un génie foudroyé (le compositeur Syd Barrett), des textes torturés – d’une rare virulence à l’égard de la société et du show-biz – , des personnalités opaques, des shows hallucinants… Au fond, le seul défaut de Pink Floyd, c’est d’avoir trouvé, de son envol en 1967 jusqu’à la mise en sommeil en 1994, un public. Énorme. D’avoir vendu des disques. Par millions. D’avoir rempli les stades. Du monde entier. Trois crimes impardonnables qui ont fait du Floyd le groupe le plus mal-aimé des deux dernières décennies.
Soudain, comme par enchantement, la malédiction s’est levée. Il est de nouveau bon ton d’apprécier Pink Floyd, d’avouer qu’on écoute leurs albums en cachette (et depuis toujours !). Les apôtres de la musique électronique et nombre de jeunes rockers cérébraux, de Air à Radiohead en passant par The Orb, y vont de leurs hommages, de leurs clins d’œil affectueux, de leurs emprunts : désormais, on entend du Pink Floyd partout. Et Echoes, rétrospective de l’œuvre du groupe, risque de se retrouver au fond de bien des souliers de Noël : le cadeau intergénérationnel par excellence !
Car Pink Floyd (du nom de deux bluesmen obscurs, Pink Anderson et Floyd Council) est une palpitante saga musicale, avec ses tragédies et ses mystères. En une suite d’albums ambitieux, ses musiciens se sont aventurés hors des sentiers battus, partant d’influences blues et jazz pour dessiner une nouvelle marge rock, entre musiques classique et contemporaine. Les quatre garçons dans les sphères ont défini les canons d’une autre musique populaire, tissant de longues plages complexes et mélodieuses. Des chansons épiques, planantes mais concises, qui constituaient la bande-son de captivantes scénographies où les artistes s’éclipsaient derrière des nuages de fumée : le grand spectacle rock était né.
Mais Pink Floyd n’a jamais promis la lune, seulement d’en explorer la face cachée. En abordant le rock autrement, il a pointé ses limites et ses excès : là où la plupart des pop stars ne chantaient qu’un hédonisme sexiste ou un militantisme démagogique, le Floyd, à travers, ses textes clairvoyants, dénonçait, lui, les dangers du succès de masse, du pouvoir et de l’isolement.
Un regret ? Que la formidable complémentarité entre Roger Waters et David Gilmour – qui était la véritable force motrice de l’œuvre floydienne – se soit muée en un affrontement : l’hypertendu bassiste parolier, empêtré dans ses névroses, a voulu, en 1983, casser le jouet. Un caprice que Gilmour, le guitariste placide, aussi doux et élégant que son style est fluide et coulant, n’a jamais digéré. Il a repris seul les commandes du groupe en 1987. Depuis, les deux hommes sont irrémédiablement brouillés. Nous les avons rencontrés. Séparément, évidemment.
David Gilmour
Hugo Cassavetti : « Cette compilation, Echoes, c’est vraiment le meilleur de Pink Floyd ? »
David Gilmour : « Oui, même s’il ne faut pas prendre ce disque comme une histoire chronologique et complète du Floyd. Il s’agit de reconstruire une œuvre cohérente en assemblant des titres puisés dans toute notre œuvre. C’est intéressant d’établir des parallèles… Est-ce un hasard si High Hopes, l’ultime morceau du dernier album enregistré par Pink Floyd, parle de la vie à Cambridge du temps où j’étais adolescent ?
Hugo Cassavetti : « Cambridge, où vous avez connu Syd Barrett et Roger Waters. »
David Gilmour : « Nous avions 14 ans, Barrett et moi, lorsque nous sommes devenus amis, en 1960. Waters, lui, était plus âgé de deux ans. J‘ai fait sa connaissance plus tard : Syd et lui jouaient déjà dans un groupe qui allait devenir Pink Floyd… A leurs débuts, je n’appréciais pas beaucoup leur musique, et, comme je suis parti jouer à travers l’Europe jusqu’en 1967, j’ai loupé leur éclosion artistique et commerciale. Je me souviens, j’étais en France, à Étretat, quand le premier album est sorti. C’était en même temps que Sergent Pepper’s des Beatles. Je trouvais ça fabuleux : je n’en revenais pas de constater à quel point Syd Barrett s‘était transformé en un compositeur accompli et original. Mais quand je suis revenu en Angleterre, fin 1967, il avait déjà perdu la boule, et j’ai retrouvé le groupe laborieux d’avant mon départ. »
Hugo Cassavetti : « Les trois autres vous ont recruté, pensant que vous pourriez sauver votre copain Syd. »
David Gilmour : « Ils espéraient pouvoir continuer à bénéficier de ses lumières ; après tout, Syd composait et chantait tout. Les autres avaient songé à recruter une pointure, Jeff Beck, pour le remplacer, mais Jeff n’était ni auteur, ni compositeur, et encore moins chanteur. Je pense que j’étais le meilleur choix : j’avais de la voix, une certaine technique à la guitare et, en plus, je venais du même coin et du même milieu qu’eux. »
Hugo Cassavetti : « Comment s’est forgé le style du Pink Floyd deuxième formule ? »
David Gilmour : « En tâtonnant, en expérimentant. En studio, ça s’est fait graduellement, mais comme nous tournions sans répit, nous avons fini par créer un style. Au début, les autres étaient très peu sûrs d’eux, notamment Roger Waters. Mais le départ de Syd, en 1968, l’a métamorphosé. Roger était dans son ombre, il a dû se mettre en avant. C’était un type intelligent et déterminé : il a assumé la responsabilité de sauver le groupe. Au bout de deux ans, nous étions devenus excellents sur scène, nous offrions un spectacle excitant. Mais il a fallu attendre l’album Meddle, en 1971, et le morceau Echoes pour voir le Floyd maîtriser le travail de studio. Avant, on collait ensemble des bribes, des morceaux épars. Echoes, qui fut construit à l’origine de la même façon, est notre premier morceau d’envergure, du style Pink Floyd. »
Hugo Cassavetti : « Mais dès Dark Side of the Moon, votre triomphe en 1973, la tension a commencé à poindre entre Roger Waters et vous… »
David Gilmour : « Disons que, jusque-là, une démocratie de principe fonctionnait, et puis, un jour, Waters a voulu qu’on reconnaisse son rôle prééminent dans la musique du groupe, ce qui était légitime. Mais jusqu’à l’album The Wall, nos disputes étaient constructives, bénéfiques à la musique – je pense même qu’on se complétait à merveille. »
Hugo Cassavetti : « Vous sentiez-vous proche du message, assez austère et paranoïaque, que Waters développait dans ses textes ? »
David Gilmour : « Pour être en désaccord, il vaut mieux avoir une alternative à soumettre. Or, je n’ai pas le talent d’écriture de Waters. Et puis je ne vois pas ce qu’on peut reprocher à Dark Side of the Moon. Même chose pour Wish You Were Here : je n’ai pas mis longtemps à accepter l’idée que l’absence, le thème évoqué, était avant tout la nôtre, celle de musiciens d’un groupe populaire qui ne savaient plus où ils aillaient. Quant à The Wall, ça demeure une œuvre remarquable mais un peu désespérée, dans laquelle je ne me retrouvais pas complètement. Roger a toujours été quelqu’un qui ne voit que le mauvais côté des choses. »
Hugo Cassavetti : « Comment expliquez-vous que Pink Floyd soit devenu l’incarnation de la décadence du rock ? »
David Gilmour : « Très tôt, en parallèle à notre succès, nous avons suscité la rancœur. Parce qu’on nous trouvait prétentieux. Et nous l’étions, puisque notre prétention consistait à pousser l’expérimentation le plus loin possible. Ce genre de parti pris est toujours risqué : il suffit d’un rien pour paraître arrogant. C’est ainsi que nous sommes devenus, selon la presse, ce « gros monstre puant et distant » qui remplit des stades. Quant au rejet de la part des punks, il m’a peu affecté. Le punk, c’était avant tout une attitude, formidable de fureur, qui me renvoyait à ce que nous étions, nous aussi, à nos débuts : de jeunes amateurs au talent naissant qui s’amusaient à faire de la musique. Et puis, après dix ans, les joyeux amateurs sont devenus des professionnels. Quand des millions de gens vous apprécient, êtes-vous censé dire « non merci » ? Non, il faut satisfaire ce public et, justement, ne pas le voler. C’est ce que nous avons fait. J’ai la conscience tranquille. Nous avons investi la plupart de notre argent dans une sono parfaite, des spectacles somptueux : à l’époque de The Wall, nous étions au bord de la faillite. »
Hugo Cassavetti : « Après la séparation de 1983, tandis que Roger passait pour un mégalo amer, vous-même, en réactivant le groupe, étiez perçu comme âpre au gain. En avez-vous souffert ? »
David Gilmour : « Je mentirais si je disais que j’ai totalement digéré les choses qui ont été écrites. On me traitait d’Oncle Picsou qui exploitait les pauvres Nick Mason et Rick Wright. Il faut savoir que Nick et Rick étaient des êtres détruits en 1987. Roger, qui pouvait être très dur, les avait cassés moralement. Il avait convaincu Rick qu’il n’était rien et l’avait congédié avant The Final Cut. Nick, ce n’était guère mieux : il ne savait même plus jouer de la batterie ! L’album A Momentary Lapse of Reason, en 1987, a au moins servi à reconstruire ces deux hommes brisés. Ne serait-ce que pour ça, je ne supporte pas qu’on attaque mon entreprise : continuer à faire vivre le Floyd. Je l’ai fait seul, par devoir et par droit, pas pour l’argent. Roger n’était pas plus propriétaire du groupe que nous. Quant à ma supposée douteuse légitimité… Combien de fois m’a-t-on reproché d’oser chanter Money sur scène ? Mais c’est pourtant moi et nul autre qu’on entend sur la version originale, comme d’ailleurs sur la plupart de nos titres les plus connus. »
Hugo Cassavetti : « La valeur du Floyd semble enfin reconnue… »
David Gilmour : « C’est d’autant plus appréciable que pendant près de vingt ans on l’a niée. A présent, il ne se passe pas un jour sans qu’un artiste ne revendique notre héritage. J’entends des parcelles de Pink Floyd dans beaucoup de disques récents, et ça me rend heureux. N’est-ce pas fantastique d’avoir à ce point réussi notre carrière, remporté un tel succès tout en préservant un relatif anonymat ? Nous avons prouvé que les rock stars ne sont pas obligées d’être d’affreux mégalos. »
Roger Waters
Hugo Cassavetti : « Comment ressentez-vous la sortir de la compilation Echoes ? »
Roger Waters : « C’est un best of, avec tout ce que ça a de subjectif. J’aurai préféré que les chansons enregistrées par Gilmour et les deux autres après mon départ ne soient pas mêlées au reste. Et que l’ordre des chansons respecte la chronologie. Au final, c’est David qui a pris les décisions. Il a voulu tout mélanger, on peut comprendre pourquoi : ça remet tout à niveau. Au fond, je m’en fiche, personne n’est obligé d’acheter le disque. »
Hugo Cassavetti : « Pink Floyd a toujours donné dans la démesure. Pourquoi ? »
Roger Waters : « J’aime la simplicité : je suis toujours attiré par le blues, par les auteurs-compositeurs. Je ne me lasse pas de Bob Dylan, de Neil Young, de John Lennon et, pour remonter plus loin, de Leadbelly, Bessie Smith ou Billie Holiday. Voilà les gens que j’admire. Je me souviens avoir vu Leonard Cohen à l’Olympia : il n’y avait rien, juste lui, des musiciens et ses mots. Mais je n’arrive pas à faire la même chose. J’ai besoin de projeter, à travers des effets visuels forts – éclairages, décors, films – les sentiments exprimés dans mes textes. Ça tient au fait que le rock, et Pink Floyd en particulier, s’adressait à des foules considérables. Dans ces conditions, l’artiste n’est plus qu’un point sur la scène, il faut créer le spectacle. Or, l’aspect visuel, de par ma formation de graphiste, m’a toujours intéressé. Mais, en vérité, la raison est ailleurs : j’ai besoin de béquilles, d’attirer l’attention. Évidement, c’était impossible, alors j’ai considéré la plupart des hommes comme des pères de substitution que je devais épater. Tout mon comportement vient de là. Avec l’âge, ça s’arrange un peu. L’autre raison pour laquelle j’en fais des tonnes, c’est pour retenir les femmes. Je n’avais que ma mère et j’avais toujours peur qu’elle m’abandonne. Avec elle, comme avec toutes les femmes de ma vie, j’ai toujours eu l’impression que je n’étais pas assez intéressant. Il fallait qu’on m’aime pour autre chose que pour moi-même. »
Hugo Cassavetti : « Vous paraissez mieux aujourd’hui. »
Roger Waters : « Je ne penses pas avoir été ce personnage ombrageux et tyrannique, voir mégalo, que l’on a souvent dépeint. C’est vrai, j’ai été longtemps dépressif et animé par un sentiment de colère, mais j’ai surtout l’impression d’avoir été victime d’une propagande insidieuse destinée à rassurer les personnes avec qui je travaillais. Ce n’est pas facile de faire partie d’un groupe où il y a une personnalité aussi créative et dominante que la mienne. Je faisais, objectivement, les trois quarts du boulot. Forcément, c’était un peu humiliant pour les autres. »
Hugo Cassavetti : « Admettez-vous que la dépression et un certain pessimisme ont nourri votre œuvre ? »
Roger Waters : « Je ne sais écrire que sur la réalité de ce que je vois, de ce qui m’entoure. Mais, dans chacune de mes chansons, je vois plus un sentiment de révolte que de pur désespoir. Tous tes textes, me semble-t’il, n’expriment qu’un désir de communication. Prenez une œuvre comme Guernica, de Picasso. C’est une violence inouïe, a priori, on y ressent toute la colère et la détresse de l’artiste. Mais l’on y voit aussi un message humanitaire. Il s’en dégage un plaisir de réunir les hommes face à l’horreur. Si ces sentiments n’étaient pas présents dans l’œuvre, elle serait juste irregardable : rien que des ruines et des cadavres. Toutes proportions gardées, on pourrait dire la même chose de mes chansons. »
Hugo Cassavetti : « Est-ce la “perte” de Syd Barrett qui vous a permis de vous épanouir comme compositeur ? »
Roger Waters : « On ne le saura jamais. En tout cas, ça m’a sacrément secoué, mis au pied du mur. Il fallait que je me mette à l’écriture, sinon le groupe était fini. Et s’il y avait une chose que je ne voulais pas, c’était de reprendre un boulot, de me retrouver dans un cabinet d’architecte. Je voulais absolument rester dans un groupe, faire de la musique. »
Hugo Cassavetti : « Set the Controls for the Heart of the Sun, votre première chanson majeure, vous évoque-t-elle un sentiment particulier ? »
Roger Waters : « A l’époque, elle ne me paraissait pas extraordinaire. Surtout que son titre est la seule ligne que j’ai écrite ! Le reste était pompé dans un recueil de poèmes chinois. Mais, avec le temps, j’ai eu d’incroyables retours. Des parents m’ont écrit pour me dire que leur enfant mourant d’un cancer avait réclamé ce titre pour l’accompagner, l’apaiser. Recevoir une telle lettre, c’est bouleversant. On ne peut que se dire : “J’ai bien fait d’écrire cette chanson.” Je ne sais toujours pas ce que les enfants ont compris ou entendu mais, d’évidence, quelque chose est passé. C’est la magie de la musique : on fait un bruit et, pour quelqu’un, quelque part, ça veut dire beaucoup. »
Syd Barrett, l’étoile filante du Floyd
Un album avec Pink Floyd suivi de deux disques ovnis en solo constituent toute l’œuvre enregistrée de Syd Barrett, génie météorique qui vit sur une autre planète, reclus. Barrett, le fondateur et l’unique force créative du Floyd originel, était tombé la tête la première dans la marmite psychédélique. La légende veut qu’on lui ait fait prendre du LSD à son insu, chaque matin dans son café. En tout cas, en 1968, le beau jeune homme surdoué s’est déconnecté de la réalité. Schizophrène, sa vie paisible constitue un des insondables mystères de l’histoire du rock. Un tragique gâchis qui n’en finit pas de nourrir l’imaginaire et les fantasmes des fans, et la culpabilité de ses anciens compagnons d’armes. « Syd vit de ses droits d’auteur, à Cambridge », raconte Roger Waters.
« Récemment, un journaliste est allé le voir pour l’interroger. Syd était en slip kangourou, en train de jardiner. Il a dit au type de glisser ses questions sous la porte, en ajoutant : « Vous savez, je n’ai rien à voir avec cette histoire. » C’est comme ça que Syd Barrett vit depuis trente ans. Il ne se voit aucun lien avec ce type que tant de gens idolâtrent. Peut-être parce que ça lui simplifie l’existence. J’ai cessé de le voir, sur les conseils de ses proches. Tout ce qui lui rappelle Pink Floyd le plonge dans une profonde dépression. Alors que, le reste du temps, il est paisible, heureux même. »
Auteurs de la page :
Marion (transcription et scans),
Walmour (mise en page),
manu (mise en page).
